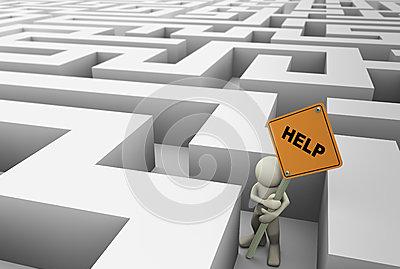La journée d’étude sur « la stratégie du secteur du transport maritime marocain et le développement du pavillon national », organisée à l’Institut Supérieur des Etudes Maritimes (ISEM) le 29 janvier 2014, a consacré l’un de ses quatre ateliers, au développement des compétences humaines.
Cet atelier m’a conforté dans mon intention, celle d’avoir voulu depuis quelques temps, partager ma réflexion sur cette question éminemment cruciale pour le devenir du secteur maritime national dans sa globalité et dont les multiples composantes devraient, sur la base d’une politique intégrée, contribuer à faire gagner à notre pays les paris de la productivité, de la compétitivité et de l’innovation.
Pour cerner la problématique, il serait judicieux d’apporter une réponse aux trois questions aussi préliminaires qu’essentielles, que se poserait toute personne s’intéressant au capital humain du secteur maritime national, à savoir : Les compétences humaines, combien sont-elles ? qui sont-elles ? où sont-elles ?
Eclairages sur le nombre et la répartition des cadres à profil maritime :
Les données que j’ai pu recueillir auprès de sources fiables, bien qu’elles ne soient pas précises au chiffre près, permettent toutefois d’avoir une idée plus ou moins proche de la réalité. La tâche n’a pas été facile je l’avoue (diversité des profils, multiplicité des postes et des organismes, absence de base de données, manque d’informations sur la destination des cadres et de leur itinéraire professionnel….), mais je ne prétends aucunement qu’elles soient le fruit d’une enquête ou d’une étude détaillée, bien que ces dernières gagneraient à être menées au plus vite, car elles représentent un passage obligé pour la détermination des besoins du secteur en compétences humaines et la mise en place des outils nécessaires à leur satisfaction.
Les effectifs à profil maritime titulaires d’un diplôme supérieur et opérant dans le secteur maritime national seraient de l’ordre de 2 111 personnes(1),répartis comme suit :
- 170 sont employés au sein de l’Administration maritime dont:
- 34 personnes au sein de la Direction de la Marine Marchande, dont 27 officiers navigants (Principalement affectés aux quartiers maritimes et au VTS de Tanger) et 7 administrateurs des affaires maritimes (2 Lauréats de l’Ecole d’Administration des Affaires Maritimes de Bordeaux et 5 du CESAM/ISEM);
- 136 personnes au Département de la Pêche Maritime, dont 18 titulaires du diplôme d’administrateurs des affaires maritimes, 66 officiers navigants (46 officiers de marine marchande et 20 officiers de la pêche) et 52 ingénieurs à profil maritime, notamment des ingénieurs halieutes lauréats de l’IAV Hassan II;
- 216 officiers navigantsdans le secteur portuaire, dont 50 à l’ANP, 80 à Tanger/Med ; 21 à Drapor, 40 à Marsa Maroc, 15 à Casa/Jorf et 10 à Somaport ;
- 26 officiers pratiquent l’enseignement maritime, dont 14 à l’ISEM et 12 dans les établissements de formation à la pêche (ces derniers relèvent du statut de formateurs. Leurs homologues au nombre de 45 exercent en qualité d’enseignants, mais en tant que fonctionnaires comptabilisés dans l’effectif du Département de la Pêche Maritimes présenté plus haut);
- 1 514 personnes sont employées aux fonctions de la navigation, dont un millier d’officiers à la marine marchande et quelque 514 officiers brevetés aux pêches maritimes ;
- 185 techniciens spécialisés opèrent dans le secteur des industries de la pêche, sur les 262 diplômés formés à l’Institut Supérieur des Pêches Maritimes d’Agadir (ISPM).
De manière générale et pour l’ensemble des profils, il a été difficile d’avoir une idée précise des cadres ayant opté pour des métiers hors du secteur maritime.
L’existence de cet effectif bien qu’important à première vue en nombre de personnes et en diversité des profils, ne doit pas être source de satisfecit et cacher le déficit en compétences humaines ressenti actuellement à des degrés divers dans plusieurs activités du secteur maritime et qui sera aggravé encore plus dans les années qui viennent.
Prémisses d’un naufrage :
Malgré les effectifs en présence, la situation des compétences humaines dans le secteur maritime connait un processus de raréfaction qui engendre un sentiment de vive inquiétude. Les politiques des différents opérateurs publics et privés n’ont souvent pas pris au sérieux cette problématique, ni pressenti ce phénomène qui, tel une vague scélérate, risque de conduire le secteur maritime national vers son naufrage. Cette inquiétude repose sur au moins trois facteurs clés :
Le premier facteur est la formation de cadres à profil maritime qui est en voie de disparition.
Pour la navigation, c’est le procédé du compte goutte qui prévaut à l’ISEM et à l’ISPM d’Agadir, seuls établissements qui forment encore un nombre réduit d’officiers navigants destinés à la conduite, à la maintenance et à l’exploitation respectivement des navires de commerce et de pêche hauturière. La raison de ce procédé est évoquée plus loin.
La même démarche est adoptée pour la formation d’ingénieurs halieutes pour les besoins de la pêche qui est assurée en tout petit nombre (une dizaine par an) à l’Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II (IAV). Elle a été arrêtée momentanément depuis cette année pour une nouvelle restructuration nous a-t-on dit. (2)
La formation de gestionnaires quant à elle, pour les besoins de l’Administration publique et du secteur privé, n’existe tout simplement pas. Elle a toujours été sous traitée en nombre très réduit dans des écoles étrangères par l’Administration, mais sans planification réelle. Parallèlement, certains cadres se sont lancés, par simple convenance, dans des études maritimes durant les années 70 et 80, pour se retrouver en fin de compte et de manière intrépide sur le marché du travail maritime. On évoquera toutefois l’expérience éphémère du CESAM abritée à l’ISEM vers la fin des années 1990, qui a permis de former 44 étudiants pour les besoins de l’administration et des entreprises maritimes privées. L’expérience n’a pas fait long feu et nous ne savons pas pourquoi elle a été discrètement abandonnée.
Le second facteur est le prévisible départ accéléré à la retraite de nombreux cadres expérimentés qui s’annonce important pour les prochaines années, puisqu’il correspond au pic des recrutements opérés durant les années 70 et 80 à la faveur des développements qu’a connus le secteur maritime national. On y rajoute, bien que peu nombreux, la défection des cadres qui quittent les métiers de la navigation pour s’installer dans des activités non maritimes (hôtellerie par exemple).
Le troisième facteur, (beaucoup plus en relation avec l’administration), est la non régénération des pépinières de cadres maritimes en raison du recrutement limité et sélectif au sein de l’administration publique, suite aux restrictions budgétaires qui affectent le secteur depuis quelques années et qui ne permet plus d’assurer la relève des partants et encore moins le transfert des expertises. Quand bien même l’Administration voudrait recruter des compétences maritimes confirmées, il faudrait qu’elle puisse les trouver. En tout état de cause, il ne faudrait pas s’attendre à ce que cette situation change, en raison du poids de la masse salariale qui plombe les finances publiques.
L’art de la navigation à vue ou l’approche de précaution
Pour les métiers de la navigation au commerce, c’est l’ISEM qui a toujours fourni les officiers navigants au pont et à la machine (officiers radio-électroniciens aussi, avant la disparition de ce profil). Ils sont actuellement 148 élèves-officiers et officiers-élèves à poursuivre leur formation à l’ISEM, dont 44 en 1ère année.
Ces effectifs correspondent-ils aux besoins en compétences actuels et futurs, en particulier ceux qui seraient générés par la reprise prévisible de l’activité du transport maritime et par le développement portuaire, au cas où les mesures d’application des stratégies sectorielles donneraient leurs fruits? J’en doute fort ! La question devient plus complexe si l’on tient compte de la durée nécessaire pour un jeune officier en vue d’obtenir, non seulement le brevet, mais également l’expérience requise pour des postes névralgiques. Il est certain que cette situation est à même de retarder encore davantage la satisfaction des besoins potentiels en compétences humaines.
En l’absence d’une commande claire de la part de tous les opérateurs du secteur censés être engagés dans la formation sur la base d’une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, l’ISEM pourrait-il faire autrement que de naviguer à vue. Sans visibilité, cet établissement doit-il continuer aujourd’hui à se hasarder dans la formation de nouvelles promotions ? Doit-il s’armer encore de persévérance, alors qu’il peine à garantir aux élèves- officiers leurs stages interscolaires et post-scolaires à bord de ce qui reste de notre flotte marchande, dans un souci premier d‘assurer à ses lauréats une qualité de formation et un premier brevet de Lieutenant. Ces questions méritent d’être posées au vu du calvaire que vit l’ISEM (Direction et enseignants) au terme de chaque année académique, pour trouver des stages embarqués à ses jeunes promotions. En effet, la ruée vers le peu de navires encore en activité, engendre une longue file d’attente, qui se traduit pour les élèves officiers par une durée de navigation aussi longue que chaotique pour l’obtention du premier brevet salvateur. Le reste des officiers effectue ses stages d’embarquement à bord d’unités mal adaptées à la formation requise d’un officier navigant au commerce (remorqueur par exemple). Une situation qui entache sérieusement l’attractivité du métier et qui de surcroit, contraint ceux qui ont tenté l’aventure, à l’abandon du parcours professionnel de navigant au profit d’autres spécialités ou métiers à terre. Un vrai gâchis, au vu du coût de la formation d’un officier navigant considéré mondialement parmi les plus élevés.
L’idée de préparer des officiers navigants pour des emplois à l’étranger est également une approche optionnelle intéressante, mais ne devrait pas être la solution par défaut, car la mission de l’ISEM est avant tout une mission d’appui au développement intégré du secteur maritime national.
Sous d’autres cieux, l’établissement n’aurait pas hésité à fermer la manne des nouvelles recrues. Une solution des plus faciles, que je ne souhaiterai pas à l’ISEM, espace unique en son genre, qui reflète encore la vocation maritime de notre pays et dont la mission première ne sera pas dénaturée je l’espère.
En ce qui concerne les métiers de navigation à la pêche, c’est l’ISPM d’Agadir qui assure une formation supérieure des capitaines et officiers mécaniciens destinés aux navires de pêche hauturière. Au stade de l’accueil des nouveaux étudiants, cet établissement est acculé d’appliquer un schéma de précaution en vue de tenir compte de l’incapacité des ressources halieutiques à supporter de nouveaux investissements dans la pêche hauturière. Cette démarche garantit au moins une insertion quasi totale pour le moment aux jeunes lauréats dont l’effectif annuel tourne autour de 56 officiers. Un petit bémol à cet avantage, c’est l’instauration de périodes de repos biologiques d’une durée annuelle de 4 mois qui allongent la durée requise pour l’obtention des brevets de navigation.

S’agissant des métiers à terre, l’Administration, les établissements publics et les entreprises privées opérant dans le secteur maritime, se sont dans la plupart des cas, appuyés sur les compétences développées dans la navigation maritime (lauréats de l’ISEM et de l’ISPM d’Agadir). On trouvera en plus en activité dans le secteur de la pêche, des ingénieurs halieutes de l’IAV Hassan II (y compris quelques ingénieurs halieutes marocains lauréats de l’Institut homologue tunisien des années 80). Si pour certains postes techniques, ces profils s’en sortent bien et dans bien des cas font preuve de performance reconnue, dans d’autres, ils y sont employés sans formation préalable les préparant à la maitrise des outils de prise en charge des missions managériales qui leur sont confiées.
Pire encore et faute de formation spécifique dans les métiers liés à la gestion des affaires maritimes et au management, la porte est ouverte aux universitaires, aux lauréats d’Ecoles d’ingénieurs ou d’autres établissements supérieurs, sans leur assurer une formation complémentaire préalable, qui soit en relation avec les multiples activités du secteur maritime.
Dans les deux cas, cette manière de faire se rajoute aux maux classiques de l’Administration publique, ce qui exacerbe le négatif impact sur le rendement et la qualité du travail. En plus, sur le terrain professionnel, cette situation est souvent source de tension entre ce que j’appellerai « les maritimistes et les terriens », focalisée sur l’aptitude des uns et des autres à se positionner aux commandes.
Entre relève et besoins nouveaux : l’imbroglio
Si rien n’est entrepris, le secteur maritime sera dans quelques années et plus qu’il ne l’est aujourd’hui, confronté à un déficit grave en cadres à profils maritimes en mesure de continuer à prendre en charge les divers métiers du secteur, du moins dans leur configuration actuelle, tant au niveau de l’Administration que du secteur privé. Cela risque d’empirer avec le développement prévisible des différentes activités composant le maritime à la lumière des stratégies sectorielles (Stratégie portuaire à l’horizon 2030, stratégie Halieutis à l’horizon 2020 et bientôt la stratégie du transport maritime et du développement du pavillon national). En effet, le développement des entreprises et des missions des institutions de gouvernance, sous l’effet des mesures d’opérationnalisation des dites stratégies, sera sans doute hypothéqué face à la raréfaction des ressources humaines spécialisées.
Cette situation sera davantage intenable avec le déficit ressenti en encadrement des nouvelles recrues et en transfert des expériences et du savoir-faire de génération en génération. Face à ce déficit, elle risque en plus d’ouvrir la voie à la surenchère et de déboucher sur la médiocrité, un fléau dont les dégâts sont considérables et l’éradication complexe.
Comment se présente le problème ?
Au niveau des entreprises existantes, tout comme celui des entreprises nouvelles qui s’installeraient dans le secteur à la faveur des nouvelles stratégies sectorielles, elles sont et seront confrontées au dilemme de gérer le peu de navigants encore disponibles et opérationnels. Faut-il employer ces officiers à la conduite et à l’exploitation des navires sous l’effet du développement possible du pavillon national et de l’installation de lignes maritimes fruit des ententes partenariales, ou les intégrer dans les métiers maritimes à terre ? Dans les deux cas, c’est « déshabiller Pierre pour habiller Paul ». Une équation difficile à résoudre me semble t-il, au vu du nombre en chute libre de ces profils. En somme, la pénurie en cadres maritimes donnera lieu à une vive compétition entre les entreprises maritimes opérant en mer comme à terre, pour s’emparer des rares compétences disponibles.
Pour les métiers liés à la navigation, les compagnies maritimes devraient comme toujours, faire face au phénomène de « volatilisation » ou du « retour à terre » bien connu chez les navigants, lesquels cherchent à débarquer vers l’âge des 40-46 ans. Cette moyenne d’âge constatée déjà au milieu des années 80 suite à une étude menée avec la contribution précieuse du Commandant Bouzoubaâ pour le compte de l’Administration maritime, est certainement à réviser à la baisse, sous le double effet des ambitions des nouvelles générations à briguer des emplois rémunérateurs stables et du manque d’attractivité pour une carrière aux horizons incertains dans la navigation maritime.
Ainsi, les compagnies de navigation, seraient acculées à recourir à du personnel étranger ; un retour de trente années en arrière, pour renouer avec l’important manque à gagner en termes de pertes d’opportunités d’emploi pour les nationaux et de sortie de devises.
Quant à l’Administration maritime et à défaut de gestionnaires maritimes formés, elle est sans le vouloir, un sérieux concurrent des entreprises privées, du fait des recrutements qu’elle opère directement parmi les officiers navigants au commerce et à la pêche lorsqu’elle dispose des postes budgétaires correspondants. Aussitôt plongés dans l’action administrative sans formation spécifique aux affaires maritimes, ces officiers tentent tant bien que mal de s’en sortir, souvent dans des fonctions pour lesquelles ils n’ont pas été formés. C’est l’Administration qui génère ainsi pour elle-même, un manque à gagner en expertise et en compétences, dont aurait pu déborder ce potentiel humain s’il avait été formé et encadré pour la gouvernance publique.
Aussi, assiste-t-on aujourd’hui au sein de l’administration, à une véritable dilution des profils maritimes confortée même par la Fonction Publique qui a mis du sien pour faire disparaitre les spécificités des corps composant les administrations publiques y compris celles du secteur maritime. En effet, au moins quatre décrets régissant le personnel administratif et technique dans l’Administration ont été pris simultanément (le 29 octobre 2010), pour introduire le principe de « l’inter ministérialité » des cadres qui, valeur aujourd’hui, n’a pas eu les effets escomptés. Par conséquent, le statut particulier comme celui des personnels des pêches maritimes et de la marine marchande ont été dissouts, pour donner à ce personnel un caractère général sans connotation maritime.
L’absence d’une Administration maritime unifiée, qui aurait dû au moins être compensée par une politique de convergence des stratégies sectorielles, n’a pas permis de faire face à de telles aberrations et encore moins de concevoir une politique intégrée du développement des compétences humaines du secteur maritime national.
Aussi et lorsque de nombreuses compétences reconnues dans le secteur s’évertuent à faire preuve de dynamisme et de ténacité militante pour ouvrir la voie à un avenir meilleur, d’autres ont malheureusement été contraintes à la résignation devant la médiocrité rampante et sans visage qui envahit petit à petit plusieurs compartiments de la société. Elle sera après l’analphabétisme, le nouveau fléau social à combattre dans notre pays, car la sécheresse des esprits finit par tarir le fleuve de la connaissance.
Sauver les acquis, forger les compétences et façonner l’identité maritime

Pour la navigation maritime, l’ISEM et l’ISPM possèdent un savoir faire reconnu en matière de formation et de certification des personnels navigants. Leur réussite dépendra du degré d’ancrage à leur milieu professionnel et de l’efficacité des mécanismes de concertation avec les partenaires professionnels pour l’identification des besoins en compétences et la conception de plans de formation destinés à les satisfaire, en vue de soutenir la mise en œuvre des stratégies maritimes sectorielles.
Sur un autre plan et indépendamment du profil et des considérations statutaires, qui souvent ont été source de dissensions, la formation devrait apporter à chaque catégorie de ressources humaines existantes ou à celles dont le recrutement est prévisible (officiers navigants, universitaires, ingénieurs etc…), les connaissances et le complément de compétences leur faisant réciproquement défaut. Cette formation aurait pour mérite de préparer une génération de hauts cadres, dont la diversité des diplômes et la complémentarité des profils d’origine, seraient source de grande richesse pour le secteur maritime national.
Ainsi, une formation additionnelle en gestion maritime apportée à des officiers navigants après une expérience donnée, serait une véritable réussite, car forgée sur des cadres ayant un riche vécu professionnel et une connaissance approfondie des multiples facettes de la navigation maritime. Cette formation porterait selon des référentiels métiers prédéfinis, sur des disciplines convenant aux fonctions du management à terre des différents postes au sein de l’Administration et des entreprises maritimes. Elle pourrait être conçue et mise en œuvre dans le cadre d’un cycle du CESAM renouvelé, ou d’un réseau de partenariat entre l’ISEM et les Universités ou les Etablissements de l’Enseignement supérieur, tel que l’ISCAE.
La dite formation serait donc pour les officiers navigants, la meilleure passerelle vers les métiers à terre, selon un plan de régulation qui puisse parallèlement garantir à la flotte nationale (Commerce et pêche), la préparation et l’insertion de nouvelles compétences.
Il me plait de souligner à ce stade, que plusieurs officiers navigants ont pu avec succès, préparer des doctorats ou des masters dans des disciplines maritimes et opèrent aujourd’hui dans l’expertise, le consulting et les assurances.
Aussi, me parait-il indispensable que les administrations concernées trouvent le cadre logique d’un partenariat ISEM/ISPM permettant d’œuvrer conjointement au développement des compétences et de jeter les ponts entre les trois secteurs phares du maritime (Pêche, commerce et ports). Pourquoi pas, puisque l’exemple est donné par des lauréats de l’ISPM employés dans le secteur portuaire et dans les activités de servitude, ou par les officiers de l’ISEM qui opèrent aujourd’hui dans le secteur de la pêche maritime (public et privé).
De même, une formation complémentaire aiguiserait les compétences des universitaires et des ingénieurs fraichement recrutés et auxquels, faute de mieux, sont directement confiées des missions de gestion des affaires maritimes au rayon d’action complexe et spécialisé. Cette formation porterait sur les aspects techniques liés à la navigation, au navire, au portuaire, aux gens de mer, à la sécurité des navires et de la navigation, au droit maritime, à la protection du milieu marin etc … Elle leur permettra d’acquérir les qualifications requises pour la gestion des différentes activités maritimes et d’avoir en plus, une meilleure compréhension des concepts et du langage des questions maritimes, au moment ou l’on constate aujourd’hui, que de nombreux intervenants dans le secteur n’arrivent même plus à s’entendre correctement.
Dans cette dynamique, les associations réellement engagées au service du secteur maritime (malheureusement peu nombreuses), ont quant à elles, un rôle éminemment important à jouer dans l’encadrement des ressources humaines et dans l’animation scientifique des rares espaces encore vivaces dans notre environnement maritime.
Par ailleurs, le secteur maritime étant une activité naturellement à dimension internationale, il serait fort judicieux de développer un partenariat agissant avec des Universités, des Instituts et des Ecoles supérieures à l’étranger, dans le but de faire partie, pourquoi pas, des institutions qui animent la réflexion et le débat sur le développement du monde maritime futur.
Aussi et dans le même ordre d’idée (nous avons tendance souvent à l’oublier), est-il impératif de développer nos capacités à sauvegarder les intérêts de notre pays au sein des instances maritimes internationales et de renforcer davantage nos aptitudes à mieux négocier face aux pays maritimes partenaires.
Ainsi, les mesures d’opérationnalisation des stratégies maritimes devraient, dans une approche concertée, donner à la formation des compétences humaines, la place qui lui échoit dans le développement du secteur maritime national, tout en encourageant les actions visant à améliorer l'attrait des professions dans ce domaine, ainsi que les perspectives d'emploi et de carrière dans les activités formant le tissu de l’économie maritime.
Il s’agit au final, de former une intelligentsia marocaine avec une identité maritime clairement affichée et un fort sentiment d’appartenance à ce secteur, loin des clivages sectoriels ou corporatistes entretenus par intérêt et parfois par ignorance.
Le pari à gagner est la pérennisation des compétences humaines dans le secteur maritime, qui sont les véritables piliers de la construction du Maroc maritime de demain.
Par RAFIKY Abdelkabir
Administrateur des Affaires Maritimes
(1) L’effectif de 2 111, ne contient pas tous les lauréats des universités ou grandes écoles ayant un profil de scientifique (biologistes, océanographes par exemple), dont une partie est employée en tant que chercheurs à l’Institut National de Recherche Halieutique (INRH), ou en qualité d’enseignants chercheurs dans les Universités et grandes écoles marocaines. Il ne contient pas également les enseignants chercheurs juristes, spécialisés en droit de la mer ou en droit maritime.
(2) L’IAV Hassan II a formé à ce jour 400 ingénieurs halieutes avec une moyenne de 10 ingénieurs par an.
Pour réagir à ce post merci de vous connecter ou s'inscrire si vous n'avez pas encore de compte.